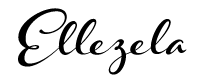Nous nous égarons. Nous partons dans la montagne, avant de faire demi tour dans un cul de sac. Il faut retrouver un chemin que nous n’avons jamais perdu. À quelques encablures qui se transforment en kilomètres tant la zone est escarpée.
Falaise, montagne, jungle et cours d’eau. Pont suspendu, layon, parking, barbecue et table de pique-nique. Décorum.
La voiture est garée, le coffre contre une table de pique-nique en dur. Notre méthode habituelle est de tirer la bâche depuis le coffre, trois mètres de long, deux cinquante de large, de manière à avoir la cuisine et la table protégée d’une inévitable ondée. Printemps.
Je traverse le fleuve à la recherche de perches (entendre : morceau de bois d’un mètre quatre-vingts environ) et me retrouve aussitôt dans une jungle abrupte. À quelques mètres, un ruisseau qui dévale la roche dans un lit de fougère.
L’endroit est plaisant. Je cherche du bois mort, mais pas pourri. Je ne veux rien couper. Tâche ardue dans une atmosphère aussi humide (et en tongue).
Ma mission accomplie, nous installons notre campement cinq étoiles.
Nous trinquons à notre réussite ; une première bière, puis une seconde, puisque rien ne nous retient.
J’explore alors notre univers de la journée. Un premier ruisseau, que nous appellerons la rivière, le courant est fort, avec de nombreux rochers. L’eau bouillonne et tourneboule dans un gargouillement ravissant. Un second cours d’eau, peu profond et fin (deux mètres de large), que nous désignerons la crique.
Là, je trouve un fil plein de racines, d’algues et de boue. Nettoyage accompli, c’est une ligne de pêche.
Je trouve du bacon de récupération dans un barbecue à moitié fini. Hameçonné, jeté dans la crique (je n’ai pas détaché la ligne, fermement enfoncée dans une berge, au cas où son propriétaire veuille la récupérer) ; quelques minutes s’écoulent et une anguille pointe son nez. Elle se rapproche maladroitement de l’appât et l’arrache de quelques coups secs. Hmpfff. Je remets mon leurre à l’eau et tiens la ligne, elle revient et mords, mais je ne parviens pas à la ferrer. Elle ne reviendra plus. Elle a senti le piège. Maline.
Méditation.
J’aime pêcher, parfois autant que Perceval. Un caillou au bout d’une corde suffirait. Je n’aime pas le poisson, voyez-vous. Ça n’aide pas. A mesure que mes papilles se brulent, j’en supporte le gout, mais sans plus. Je l’évite donc autant que possible, et notre relation s’arrête là.
Mais j’aime pêcher. Petit, c’était un véritable hobby. On passait des heures au bord des lacs (Kourou en possède trois), à attraper sauterelles et vers de terre, à ajuster nos poids, à taquiner l’eau calme. Nous relâchions nos prises (souvent minuscules) et nous étions fiers. C’était juste pour savoir le faire et pour passer le temps, j’imagine.
Au fur et à mesure, nos techniques se sont spécialisées, et les poissons se devaient d’être de plus en plus gros. Seulement vient un moment où la bête doit mourir et il faut la manger… Au mieux je le faisais sans envie particulière, pour passer un moment avec un ami, posé sur une berge, ou dans les filets du ponton des pêcheurs.
Chute.
Moi, en short-maillot, qui viens de me vautrer dans la crique dont les berges sont glissantes ; je suis un peu idiot mais surtout ravi ; j’ai l’impression d’avoir huit ans et d’être en forêt. Je sors en essayant de ne pas perdre mes savates ; ni ma ligne (et de ne pas me la planter dans les doigts)
Interpellation.
Un homme me questionne ; L’homme est d’une beauté loufoque. Bonnet rasta qui cache une multitude de locks grisonnantes, barbe blanche immaculée ; peignoir bleu roi. Œil malicieux. Je suis près de son van ; je pêche l’anguille ?
Oui. Mais je ne sais pas vraiment ce que je fais. Sourires.
On discute ; d’abord technique : quel appât, quel coin d’eau ? puis informel : qui suis-je, ou vais-je, comment, pourquoi ? Et lui ? Ça s’enchaine vite.
C’est une amitié éphémère qui est en train de naître, sous couvert d’intérêts communs : le vivant ; un partage d’expériences, ici et maintenant avec la curiosité comme seule maîtresse. Peut-être un brin de fierté, aussi. C’est un original, comme on dit ; délégué syndical mit au ban, devenu maitre brasseur et cultivateur de ganja, il vit dans un village fantôme ; il sort d’une déception amoureuse avec une femme, dont il me montrera des photos, qui a mis la boxe féminine néo-zélandaise sur le devant de la scène.
Il me parle de son van, des spots à visiter, de ses vins de fruits, de son cannabis, de son amour. Il n’a jamais bu ni fumé, ou alors très peu ; il aime seulement le processus. Ses rides et ses manières disent la vérité, je crois. Mais il est joueur et aime faire des croisements, il devient très bon, et finalement sa weed se retrouve partout dans le pays ; comme il est consciencieux, il garde ses variétés étiquetées, et finalement les flics lui tombent dessus. Il a eu le choix : on éteint les lampes, ou on va en taule. Il a tout stoppé, mais la culture lui manque.
J’écoute. C’est un fou-sage. Elles sont peut-être exagérées, mais ce sont de belles histoires. Et ce sont celles que je préfère : elles rassemblent la romance et la vie.
Il me raconte un peu du reste aussi.
Pièce principale d’un portraitiste local, il aura, à l’occasion d’expositions, été vu dans toute la nouvelle Zélande ; il me montre l’affiche : lui, en plan taille, avec un t-shirt dénonçant le mauvais traitement des Maori (je crois), ses clés autour du cou. Puis une photo : lui, devant l’affiche lors de la première à Auckland, l’air pataud, et une seconde photo sous la première (c’est un album) : lui devant la même affiche, toujours à Auckland, la bite à l’air, ravi. « We like to mess around » me glisse t’il avec un sourire de gamin espiègle. Tu peux le dire.
La nuit vient, je rejoins mon amour et lui raconte la rencontre ; nous dînons ; puis je repars à la pêche. Cette fois je croise des maoris. Un peu brutal, un gars me demande ce que je fous là. Moi, comme un con avec ma ligne à la main, je lui dis que je viens pêcher l’anguille. Que je ne sais pas vraiment ce que je fais mais que j’essaye. Radouci, il m’explique que je ne dois pas flasher l’eau avec ma torche et me file un appât.
Je reste une vingtaine de minutes avec eux (un couple et un petit frère) ils viennent de la côte, d’un village que je serais incapable de nommer et qu’ici, c’est un super coin pour les anguilles. Il y a des « bro » à chaque fin de phrase, mais rien d’amical dans les inflexions. La fille crie : elle en a une. Silence. Ça ne mord plus. Les voix chuchotent. Je pars.
Je lance ma ligne dans la rivière, j’ai repéré une berge calme, où un contre-courant se forme ; d’après mes dernières informations, c’est un spot.
Bingo. J’ai une anguille en quelques minutes. Je la sors, elle s’entortille dans ma ligne.
Je devrais l’offrir au maori ! En plus c’est son appât, ça se tient ! Mais bon… J’aurais l’air con à faire tout le chemin avec l’anguille au bon de l’hameçon, ça fait quand même trois cents mètres (le chemin, pas l’anguille). Faut que je l’enlève. Mais pour ça faut que je la tue, sinon elle va juste s’entortiller autour de mon bras, et puis elle est glissante, putain. Bon, lui couper la tête…. Merde, mon couteau n’est pas assez aiguisé. Bon, c’est fait. Ha mais merde ! Si ça se trouve il préfère les garder vivante pour qu’elles soient bien fraiches quand ils les préparent… bordel, je réfléchis trop là. Bon, tant pis, je me la garde. Mais faut que je la vide avant. La vache ce que c’est glissant ! Ok, alors, d’abord, tâcher d’enlever la « slime ». Un peu de sel… ok, beaucoup… je la cale dans l’herbe, bon, je peux à peu près la maintenir. Cool. Rah, bordel ce couteau n’est vraiment pas assez aiguisé.
Oh que c’est chiant de se retrouver accroupi dans l’herbe à essayer de vider un poisson en pleine nuit quand la pluie tombe drue. Connerie de guerre.
Bon, done et well done. Allez, hop, un tour dans la rivière, on se lave les mains où la « slime » a presque fini de sécher malgré la flotte qui tombe, on nettoie la poiscaille, on met le tout dans un sac plastique, et le sac plastique dans une glacière.
Je refais un tour où j’ai attrapé l’animal, un rituel-pensé pour son destin désormais scellé et mis au frais. Je sais, c’est con, mais je suis comme ça. L’air est frais, la pluie s’est arrêtée, mes manches puent le poisson, je suis content.
Direction sommeil.
Le lendemain, Rasta Santa (ainsi l’avons-nous nommé) reviens, je luis montre la prise, il m’explique comment bien la préparer, en l’essuyant dans l’herbe et les branches pour enlever la slime (ce que j’avais déjà un peu fait) puis m’explique que c’est meilleur fumé, mais que ça marche bien grillé aussi. Nous n’avons pas vraiment le temps de faire un feu, et tout est foutrement humide, il reviendra un peu plus tard avec un « grill instantané ». Je lui propose de m’aider à la préparer et à manger un bout avec nous, il refuse, il a déjà bien de quoi faire, il se prépare un poulet rôti sur lit de pommes de terre. Ma foi, pourquoi pas.
Laurène se moque : « Il est tombé amoureux de toi ?! » Faut dire qu’il est revenu chaque matin, avec toujours plus de photos et de discussions. Remarque, ça tombe bien, parce qu’avec ses yeux bleu vif cachés derrière les broussailles de ses sourcils et toutes ses histoires, moi il m’a déjà séduit.
Phase repas : Grill allumé (cinq secondes chrono), anguille débitée en filets maladroits (10 minutes… note à moi-même : acheter une pierre à aiguiser).
On saupoudre la viande d’ail et de sel, on cuit ça avec la peau, pour que le gras s’infiltre dans la chair, puis on consomme. Ça le fait, ça n’a pas trop le goût de poisson ; ni même de vase. Dans le doute j’ai le « chipotle » à portée de main.
Nous remballons le camp et partons un peu plus tard, en début d’après-midi, après avoir dit au revoir à nos voisins et avoir pris le numéro du Rasta Santa. On ne sait jamais.